le monde des nouveaux autoritaires
« Nous n’en sommes qu’au début de la géopolitique des nouveaux autoritaires, dont la Syrie aura constitué la scène primitive. » ( Michel Duclos )
Face à ce courant politique qu’incarnerait au mieux Vladimir Poutine, Michel Duclos plaide, comme l’Institut Montaigne dont il est conseiller spécial, pour le libéralisme.
Mais dit-il, « le libéralisme de l’avenir aura intérêt à donner une juste place au sentiment national et au droit de défendre des valeurs conservatrices en démocratie ». Bref, un libéralisme conservateur,
/http%3A%2F%2Fwww.institutmontaigne.org%2Fressources%2Fimages%2FBlog%2Fles-nouveaux-autoritaires-portraits-des-nouveaux-hommes-forts-twitter.jpg%3F1573984129%23width%3D800%26height%3D418)
Les nouveaux autoritaires - portraits des nouveaux "hommes forts"
Ils illustrent [...] la prévalence d'un nouveau type de dirigeants politiques emblématiques de notre époque : les "hommes forts", qui exercent un pouvoir personnel en écartant le plus possible ...
https://www.institutmontaigne.org/blog/les-nouveaux-autoritaires-portraits-des-nouveaux-hommes-forts
Avec les " nouveaux autoritaires ", les libéraux se forgent un nouvel ennemi
Le président turc Erdogan se rend ce mercredi 13 novembre à Washington pour y rencontrer le président Trump, alors que le dirigeant turc s'est entretenu samedi avec Vladimir Poutine. Au menu : l...
Le président turc Erdogan se rend ce mercredi 13 novembre à Washington pour y rencontrer le président Trump, alors que le dirigeant turc s’est entretenu samedi avec Vladimir Poutine.
Au menu : le sort de la Syrie, où Bachar el-Assad a repris le pouvoir. Ces quatre hommes sont, avec une quinzaine d’autres, des personnages du livre Le monde des nouveaux autoritaires qui vient de paraître.
Qui est l’ennemi des libéraux ?
Pendant longtemps, la réponse semblait aller de soi : c’était le « totalitarisme ».
Sous cette appellation, Hannah Arendt regroupa, dès 1951, le nazisme et le stalinisme. Puis d’autres auteurs élargirent le champ…
Jusqu’à François Fillon qui, dans un livre de campagne de 2016, voulait « vaincre le totalitarisme islamique ».
En France, l’antitotalitarisme s’imposa dans les années 1970, autour de personnalités comme Raymond Aron, François Furet, Claude Lefort, Jean-François Revel ou Bernard-Henri Lévy.
Quarante ans plus tard, le monde a radicalement changé, comme le rappellent les cérémonies de la chute du mur de Berlin et les « antitotalitaires » libéraux sont en deuil de doctrine.
En tâtonnant, ils cherchent à tracer une nouvelle ligne de front entre « eux » et « nous », à définir l’ennemi ou l’adversaire.
Les néoconservateurs comme Paul Kagan le font à coups de sabre, d’autres avec précision et nuance.
C’est tout le sens du livre Le monde des nouveaux autoritaires (1) publié sous la direction de Michel Duclos en collaboration avec l’Institut Montaigne.
Ecrits par les meilleurs spécialistes, les chapitres d’une lecture agréable étaient déjà parus à l’été 2018 sur le blog de l’Institut Montaigne.
Ils sont augmentés d’une quarantaine de pages inédites de Michel Duclos, d’une portée plus générale.
« Je ne suis pas parti d’un concept mais de personnages, confie à l’Opinion l’ancien diplomate, également auteur d’un récent livre sur La longue nuit syrienne.
Lorsque l’on met ses portraits sur un mur, on observe un extraordinaire air de famille, un style commun ».
Ce n’est pourtant pas évident au premier coup d’œil, tant ces personnalités « sont différentes et viennent d’horizons différents ».
Preuve de la difficulté de les réunir sous un même chapiteau au prétexte qu’on ne les aime pas tellement, Michel Duclos les classe en 3 catégories.
- D’abord, les « nationalo-populistes » : Bolsonaro (Brésil), Kaczynski (Pologne), Modi (Inde), Netanyahou (Israël), Salvini (Italie) et Trump (Etats-Unis).
- Ensuite, les « néo-autoritaires » : Dutertre (Philippines), Erdogan (Turquie), Kagame (Rwanda), Khamenei (Iran), Maduro (Venezuela) et Orban (Hongrie).
- Enfin, les « autoritaires assumés » : Assad (Syrie), Mohammed ben Salmane et Mohammed ben Zayed (Arabie saoudite et Emirats arabes unis), Kim Jong-un (Corée du Nord), Poutine (Russie), Sissi (Egypte) et Xi Jinping (Chine).
Ce qui les caractérise, c’est qu’« ils sont hostiles au modèle libéral », note Michel Duclos, qui décrit des « régimes hybrides », qui ne ressemblent pas à ce que l’on a connu au XXe siècle.
Il s’agit d’un « national-populisme » qui débouche sur un « nouvel autoritarisme ».
Selon l’auteur, « il n’est pas dans notre intérêt d’installer une démarche de bloc à bloc, mais au contraire de chercher à les diviser » sur la scène internationale en jouant de leurs contradictions.
Pour garder les choses en perspective, il faut quand même rappeler qu’une tradition remontant à l’Antiquité fait de l’étude de l’Histoire, ( Jacques Bainville ) la seule école possible des Hommes d’Etat – le seul laboratoire dont ils disposent.
Les historiens pratiquent une science ;
les hommes d’Etat cherchent à rationaliser leur action ; leur rapport à l’Histoire ne peut être le même. ( Michel Duclos )
Bolsonaro é incluído em livro francês sobre líderes autoritários da atualidade | Voz da Bahia
O livro "Le monde des nouveaux autoritaires" (O mundo dos novos autoritários), resultado de um projeto desenvolvido pelo think tank francês Institut Montaigne e recém-lançado como livro, coloca...
La publication le qualifie de dirigeant populiste dans une démocratie en régression et affirme que son élection en 2018 fait courir un risque réel de désintégration de la démocratie du pays vers l'autoritarisme. Le travail a eu la collaboration de chercheurs de différentes universités, qui ont été invités à dessiner des profils de personnalités publiques aux tendances autoritaires.
«Jair Bolsonaro est sorti de nulle part», explique Michel Duclos, organisateur du livre, à propos du président brésilien. "Il a pris le commandement d'un pays important qui, avec le président Lula et, dans une certaine mesure, Dilma Rousseff, a eu une influence significative au niveau international grâce à son grand statut émergent", a-t-il écrit.
Pour M. Duclos, Bolsonaro "n’a peut-être qu'une marge de manœuvre limitée dans la politique internationale", mais son accession au pouvoir symbolise un "tournant" - pour lui, il s'agit "d'un revers pour un pays qui vient de sortir du sous-développement". .
Le profil complet de Bolsonaro a été rédigé par le professeur Frédéric Louault, expert politique brésilien à l'Université libre de Bruxelles, à la suite de l'élection du capitaine à la retraite et ancien député fédéral. Selon Louault, "le Brésil a plongé dans l'inconnu" dans le "plus gros chèque en blanc" signé par les Brésiliens de l'histoire.
L'auteur souligne le rôle sans importance que Bolsonaro a joué au Parlement pendant trois décennies et énumère ses déclarations autoritaires, préjugées et racistes, notamment sa défense de la dictature militaire et la répression des opposants.
«Les Brésiliens qui ont voté pour lui au deuxième tour de l'élection présidentielle n'ont pas tenu compte des excès rhétoriques, de son inefficacité au cours des trente dernières années, ni même de la vacuité de son programme. Mais ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Jair Bolsonaro est aussi clair que l'eau bénite. Le nouveau président est une Bible ouverte: il dit ce qu'il pense et pense ce qu'il dit. Vos mots sont vrais », dit-il.

"Le risque de désintégration de la démocratie et de dérive du gouvernement dans une forme d'autoritarisme ne doit pas être minimisé, pas plus que le mépris de Bolsonaro pour les institutions démocratiques, les droits de l'homme et les libertés fondamentales", a-t-il ajouté.
Outre Bolsonaro, le livre comporte les noms suivants: Donald Trump, président des États-Unis; Vladimir Poutine, président de la Russie; Xi Jinping, président de la Chine; Narendra Modi, Premier ministre indien; Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien; Matteo Salvini d'Italie; Rodrigo Duterte, président des Philippines; Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie; Paul Kagame, président du Rwanda; Ali Khamenei, dirigeant suprême de l'Iran; - Nicolás Maduro, président du Venezuela; Viktor Orban, Premier ministre de la Hongrie; Bachar al Assad, président de la Syrie; Mohammed bin Salman et Mohammed bin Zayed d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis (réunis dans un seul profil); Kim Jong-un de Corée du Nord; Jaroslaw Kaczynski de Pologne; et Abdel Fattah al-Sissi, président de l’Égypte. (Magazine Forum)

FRANÇOIS CLEMENCEAU ( @leJDD )
Il fallait le regard transversal de l’ancien diplomate, conjugué aux travaux méthodiques des chercheurs, experts de chacun des pays présidés aujourd’hui par un chef d’État « autoritaire », pour aboutir à cet annuaire glaçant des 19 dirigeants qui font trembler le monde d’aujourd’hui. Michel Duclos, conseiller spécial à l’Institut Montaigne, n’a rien oublié de ses séjours à Moscou, d’où il a assisté à la fin du communisme, et à Damas, où le poids du système clanique et dictatorial des Assad a fait de l’ophtalmologue Bachar un oppresseur en chef.
Certes, Paul Kagame au Rwanda et Jair Bolsonaro au Brésil ne sont pas faits du même moule que Kim Jong-un en Corée du Nord. Mais Michel Duclos s’est autant intéressé à leurs dénominateurs communs qu’à ce qu’il se passe dans leurs sociétés. D’où vient, y compris dans les pays occidentaux, cette idée que « la démocratie n’apparaît plus nécessairement comme une valeur en soi, que l’efficacité doit être privilégiée et que d’autres systèmes que la délibération démocratique peuvent avoir leurs mérites » ? C’est là que se rejoignent des êtres aussi différents que Donald Trump et Nicolás Maduro, Narendra Modi et le maréchal Sissi. Parce que le nationalisme qu’ils incarnent, leur refus de se soumettre à la complexité des choix ou à la science les conduisent à exercer le pouvoir en respectant de moins en moins les fondamentaux de la démocratie libérale. Les portraits sont saillants, les analyses au scalpel, avec cette conclusion que les anathèmes ne servent à rien, surtout lorsqu’ils sont déclamés par des élites apeurées.
D'un bout à l’autre du globe, démagogues, « hommes forts », autocrates et dictateurs en tout genre se suivent mais ne se ressemblent pas – tout en présentant un air de famille. Qui sont ces nouveaux autoritaires qui de plus en plus définissent l’air de notre temps et déterminent la politique mondiale ? Pour mieux comprendre l’itinéraire de ces dirigeants et les conséquences géopolitiques de leur montée en puissance, l’Institut Montaigne et l’ancien diplomate Michel Duclos ont fait appel à d’éminents spécialistes qui dressent un portrait psychologique, intellectuel et politique de chacun d’entre eux.

De Poutine, Bolsonaro et Kim Jong-un à Trump, Orban, ou Erdogan, ou encore Salvini, Mohamed ben Salman et Maduro, dix-huit personnages hauts en couleurs – parfois effrayants, souvent menaçants – forment la famille des « nouveaux autoritaires », divisée en trois grandes fratries : nationalo-populistes dûment élus, « néo-autoritaires » en transition entre deux mondes et authentiques dictateurs.
Issus de généalogies variées, leurs positions diffèrent sur l’arc qui conduit de la démagogie au despotisme. Ils puisent tous cependant, à des degrés divers, dans la même « boite à outils » anti-libérale, où pêle-mêle s’entassent une xénophobie assumée, l’exaltation d’un rêve identitaire, la vindicte contre l’establishment, le contrôle des médias, la kleptocratie, et l’identification du pouvoir « populaire » à un dirigeant « fort ».
La jonction possible entre les nouveaux autoritaires de tous poils représente désormais une menace grave pour la démocratie libérale. D’ores et déjà, ils ont imposé dans les esprits dans le vaste monde une « tentation autoritaire » se substituant à l’attraction du « modèle libéral » qui paraissait avoir triomphé après la chute du mur de Berlin.
Biographie de l'auteur https://t.co/OsPaRX3WRW?amp=1
Ancien ambassadeur, Michel Duclos est conseiller spécial géopolitique à l'Institut Montaigne.
Il est l'auteur à l'Observatoire de La Longue Nuit syrienne ( ci-après )
/https%3A%2F%2Fstatic.atlantico.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fmedia_image_960x533%2Fpublic%2F000_1JX8H7.jpg%3Fitok%3D2biCoeS1%23width%3D960%26height%3D533)
Comment l'Iran a basculé dans un régime autoritaire sous l'égide de l'ayatollah Khamenei
Michel Duclos publie un ouvrage collectif, "Le monde des nouveaux autoritaires", aux éditions de L'Observatoire. D'un bout à l'autre du globe, démagogues, "hommes forts", autocrates et dictateur...
Dans les années 1960 on assiste à la parution de l’ouvrage de l’intellectuel Jalal Al‑e Ahmad, Occidentalite (ou La Maladie occidentale) qui dénonce la prépondérance du modèle culturel occidental comme une forme insidieuse de domination sur les sociétés musulmanes. Al‑e Ahmad, d’une famille cléricale, avait été profondément marqué par l’influence marxiste mais progressivement, il a pris conscience que seul l’islam pouvait promouvoir en Iran une révolution susceptible de renverser le pouvoir pro‑occidental et pro‑impérialiste du chah. De même, Ali Shariati, un intellectuel provenant d’une famille religieuse, pensait que l’islam chiite authentique était révolutionnaire (le chiisme rouge, contre le chiisme noir, quiétiste et doloriste). La période qui s’étend sur les deux décennies 1960 et 1970 est ainsi propice à des idées convergentes entre l’extrême gauche marxiste et les islamistes radicaux. L’ayatollah Khamenei a baigné dans ce milieu où en dépit des divergences de fond (les membres de l’extrême gauche étaient laïcs, ils n’étaient pas loin de partager l’idée de la religion comme opium du peuple, alors que les partisans de l’islam révolutionnaire prônaient une version de l’islam destinée à instaurer une théocratie, du moins dans la frange khomeyniste – la frange partisane de Shariati était implicitement anticléricale) existaient des points de convergence.
La vision anti‑occidentale de cette génération se reflète dans la conception globale de l’ayatollah Khamenei, arc‑boutée sur une posture islamiste et fondée sur l’idée que l’Islam et l’Occident sont incompatibles dans leur nature profonde.
Cette conception d’un chiisme radicalisé a trouvé son apogée dans les leçons proférées par l’ayatollah Khomeyni à Nadjaf portant pour titre « Velayat-e faqih » où il prônait un pouvoir islamique dont le dirigeant serait un clerc chiite au courant des affaires politiques de la société. Cette conception théocratique du chiisme est dans une grande mesure l’équivalent de la notion de « Hakimiyah » dans le sunnisme, prôné par le Pakistanais Abul Ala Maududi et radicalisée par l’Égyptien Sayyed Qotb. L’exil de l’ayatollah Khomeyni en Irak à la suite des troubles du début des années 1960 a créé un choc et surtout, un nouvel esprit contesta‑ taire chez une partie du clergé, que l’on trouve chez de jeunes clercs comme Rafsandjani (membre éminent du clergé khomeyniste), Khamenei lui‑même, Motahhari (mis à mort au début de la révolution de 1978 par des extrémistes islamiques du groupe Forqan) et bien d’autres religieux convaincus que l’Islam ne saurait être sauvé en Iran autrement que par une théocratie islamique. L’idée remonte en fait au XVIIIe siècle mais ce n’est que dans cette période cruciale qu’elle emporte la conviction d’une fraction du clergé. Celle‑ci en est venue à s’opposer à la tendance quiétiste et pendant la crise révolutionnaire en Iran, a su s’imposer comme la version dominante du chiisme. L’ayatollah Khamenei appartient à cette tendance radicale, théocratique et révolutionnaire (au sens d’une révolution conservatrice), sa conception du monde et son rapport à l’Occident étant indélébilement marqués par cette vision militante de l’islam.
L’ayatollah Khamenei a su se donner une stature intellectuelle en publiant des ouvrages et des traductions qui ont distingué le nouveau clergé de l’ancien. Il a publié ou fait des conférences sur l’art, les prières quotidiennes, « La Bonne Compréhension de la religion », « L’Esprit de Tawhid (unicité divine) ou La Dénégation de l’idolâtrie », « L’Agression culturelle » (thématique commune aux intellectuels tiers‑mondistes des années 1960‑1970 et le clergé traditionnaliste ou fondamentaliste comme l’ayatollah Mesbah Yazdi, chef de file des clercs fondamentalistes et théocratiques), « Connaître l’ennemi » (dochman chenassi), « Le Djihad pour l’autarcie » ( djihad khod-kafai), « Nécessité du retour au Coran », mais aussi des traductions de l’arabe, notamment de Sayyed Qotb, mais aussi des écrits sur les musulmans et leur rôle dans le mouvement de libération en Inde (d’Abdul‑Mun’em Namri)…
Il possède une culture littéraire significative et a lu un grand nombre de poètes et d’écrivains iraniens ou étrangers, certains comme Victor Hugo l’ayant profondément marqué selon ses propres dires (en particulier Les Misérables), ainsi que Jean‑Paul Sartre et Bertrand Russell. Selon lui, les révolutions sont représentées surtout par des œuvres littéraires remarquables et l’Iran n’y échappe point.
Cependant, sa vision sur les diverses questions qui agitent le monde moderne est profondément conservatrice, voire autoritaire. À son sens, le rôle de la femme est d’élever des enfants et de constituer un soutien à la famille patriarcale plutôt que de s’engager dans l’espace public ou de revendiquer l’égalité avec les hommes. Tout comme une grande partie des intellectuels tiers‑mondistes des années 1960‑1970, il est convaincu que la démocratie occidentale est inventée pour affaiblir les sociétés musulmanes et assurer leur subordination à l’Occident.
L’ayatollah Khamenei, Guide suprême depuis 1989, a su se maintenir au pouvoir en restructurant la théocratie islamique et en lui imposant sa propre marque.
Pour commencer, il s’est appuyé sur l’Armée des pasdarans dont il a assuré la prospérité en lui accordant de plus en plus des privilèges économiques et en ouvrant la voie vers la constitution d’un véritable empire économique parallèle sous leur égide, échappant au gouvernement et muni de nombreuses prérogatives dont plusieurs ports francs, important et exportant sans aucun droit de regard sur ses activités par le pou‑ voir exécutif.
L’Armée des pasdarans et ses différentes branches (Bassidje, son antenne dans les quartiers populaires, les milices islamiques appelés le « Hezbollah » sous son égide…) a su mettre fin aux protestations au moment des crises multiples qu’a traversées le régime : le mouvement étudiant de 1999, le mouvement réformiste sous l’égide du président Khatami (1997‑2005), le Mouvement vert de 2009, les tentatives d’autonomisation du président Ahmadinejad (circa 2012‑2013), mais aussi le mouvement du « pain » de 2017 (une centaine de villes ont vu des manifestations de protestation contre le pouvoir à cause de la cherté et du fossé grandissant entre les classes sociales).
Par ailleurs, l’ayatollah Khamenei s’est appuyé sur les Fondations révolutionnaires et sur celle d’Astan Quds Razavi, qui gère les biens de mainmorte de l’imam Reza dans la province de Khorassan au nord‑ouest de l’Iran et qui dispose de plusieurs milliards de dollars de biens, non seulement en Iran, mais aussi en Inde, au Pakistan et ailleurs. Ces Fondations lui procurent des moyens financiers extrêmement significatifs qui lui permettent de court‑circuiter le gouvernement et ses revenus déclarés. Par leur truchement il peut financer sa politique au Liban, en Irak, en Afghanistan, en Syrie et dans d’autres parties du monde. Les moyens financiers dont dispose l’ayatollah Khamenei en font un homme puissant, mais à la différence de l’Arabie saoudite où les caisses de l’État et celles du roi sont identiques, dans son cas, ce ne sont que par des stratagèmes plus ou moins opaques qu’il parvient à s’assurer la mainmise sur ces ressources, fruit d’une hégémonie acquise sur le tas. L’exécutif n’a aucun moyen de contrôle sur celles‑ci et le Guide suprême peut les utiliser à sa guise et sans avoir de compte à rendre à une instance quelconque.
Un autre levier dont l’ayatollah Khamenei s’est assuré la tutelle est le système judiciaire. En Iran, celui‑ci échappe entièrement au contrôle de l’exécutif et du législatif. Cela pourrait paraître « démocratique » mais en fait, il s’agit d’un système répressif et opaque : tout individu posant des problèmes au pouvoir théocratique peut se voir accuser et condamner à des peines quelquefois très lourdes.
L’ensemble de ces instruments aux mains du Guide marginalisent le pouvoir du président de la République et du Parlement ou des autres institutions électives.
L’ayatollah Khamenei a su mettre à contribution chacun d’entre eux sous une forme qui rend illusoire toute contestation de son hégémonie au sein du bloc qu’il dirige. Pratiquement tous les ministères ont leur équivalent dans la « cour » du Guide suprême ; cette duplication et la mainmise sur les ministères clefs (le ministère de l’Intérieur, des Renseignements, mais aussi de l’Éducation nationale et tout particulièrement, des Affaires étrangères) font du Guide suprême le détenteur du pouvoir réel dans la société. Il a reproduit une structure du pouvoir qui a des similitudes avec celle du makhzen au Maroc où le roi détient le pouvoir par des leviers plus ou moins visibles en manipulant différentes instances et en neutralisant toute volonté d’appropriation du pouvoir par les institutions formelles.
Pour l’ayatollah Khamenei, les réformistes constituent l’ennemi institutionnel le plus dangereux. Ils entendent changer la nature du régime de l’intérieur, en l’ouvrant à une version plus ou moins démocratique où le pouvoir du Guide suprême serait remis en cause au nom de la souveraineté populaire. Il a su neutraliser le mouvement qui avait porté le président Khatami sur le devant de la scène en 1997 et ensuite, maîtriser le Mouvement vert en l’étouffant progressivement et en mettant sous les verrous ses leaders (Moussavi et Karrubi), par une répression crescendo (aux alentours de 150 morts et 4 500 torturés et plusieurs milliers exilés hors d’Iran). La dextérité de l’ayatollah Khamenei à venir à bout de l’opposition interne a été fondée paradoxalement sur les présidents de la République qui, jusqu’à présent, ont dû assumer à leur corps défendant les déficiences du système et le soustraire à la responsabilité des conséquences de sa politique étrangère. Avec l’ère Trump et sa sortie de l’accord sur le nucléaire iranien (dit JCPOA), la dissension entre les réformateurs et les conservateurs s’est atténuée, voire éclipsée, mais par un paradoxe apparent, c’est l’ayatollah Khamenei qui est devenu le chef visible et désormais responsable de la marginalisation de l’Iran sur la scène internationale. Jusqu’à présent, il a évité la guerre avec les États‑Unis, mais la situation extrêmement fragile de l’économie et l’appauvrissement à vue d’œil de la société iranienne délégitiment chaque jour un peu plus un pouvoir qui n’a rien d’autre à offrir à la société que le déclin et la descente en enfer. Par un autre paradoxe apparent, ce régime, de plus en plus délégitimé, est de moins en moins contesté en raison d’un sentiment de fatalité et de perte de pouvoir économique des classes moyennes, victimes de la politique américaine et de la corruption mais aussi de l’intransigeance de la théocratie en place. Tant que l’ayatollah Khamenei est en fonction, à moins d’une guerre avec l’Occident, son pouvoir demeure incontesté, quoique délégitimé, faute d’adversaire et en raison de l’absence d’une opposition crédible à sa suprématie.
La personnalité de l’ayatollah Khamenei a été sans doute décisive dans la tournure autoritaire du pouvoir en Iran depuis la mort de l’ayatollah Khomeyni en 1989. Par‑delà cette dimension personnelle, on ne peut que constater la permanence des pouvoirs autoritaires en Iran depuis la période de modernisation de Reza Chah. Ce dernier était un autocrate, créateur d’un État centralisé et moderne, rompant à beaucoup d’égards avec le passé mais ancré dans le despotisme. De même, son fils Mohammad Reza, après une période de gestation, et suite au mouvement nationaliste de Mossadegh (1950‑1953) et le coup d’État anglo‑américain pour renverser ce dernier, est devenu un despote modernisateur, surtout après l’élimination des grands propriétaires fonciers par la réforme agraire du début des années 1960. La révolution de 1979 a été en grande partie la conséquence de ses excès et de son hubris. Celle‑ci a abouti à une théocratie islamique et a débuté par le leadership de l’ayatollah Khomeyni et le populisme unanimiste sous son règne. La guerre déclenchée par l’Irak en 1980 a consolidé ce pouvoir par le réflexe unitaire de la société iranienne contre l’ennemi commun qui avait envahi une partie du territoire, au sud‑ouest, le Khouzistan, principale province pétrolière de l’Iran. À la mort en 1989 du fondateur du nouveau régime, le clerc Khamenei a été élu par le Conseil des experts et progressivement, il s’est forgé une identité autocratique sous la dénomination de l’ayatollah Khamenei. Comme le chah, il a traversé les turbulences de la contestation, que ce soit sous la présidence de Khatami (1997‑2005) mais aussi le Mouvement vert (2009) qui lui avait disputé la légitimité.
En un sens, ces personnalités autoritaires ont poussé l’État et la société iranienne vers une posture défensive ; en un autre sens, la nature même de cet État rentier du pétrole est une incitation à l’autoritarisme, facilitant la tâche des détenteurs despotiques du pouvoir par une rente pétrolière autonome vis‑à‑vis de l’activité économique de la société.
L’ayatollah Khamenei, imbu de l’idéologie islamiste et tiers‑mondiste marquée par l’anti‑impérialisme, l’antisionisme, l’anti‑américanisme ainsi que la tendance pro‑palestinienne des années 1960‑1970, a réussi à créer une dynamique régionale centrée sur la Syrie (appuyant le régime d’Assad), le Liban (soutenant le Hezbollah), l’Irak (défendant les différentes tendances chiites irakiennes) et même certaines fractions palestiniennes (le Hamas). La concomitance de l’autoritarisme et d’un pouvoir qui prend la société en otage, notamment par Bassidje et différentes organisations issues de la révolution de 1979, constitue en grande partie l’apport de l’ayatollah Khamenei. Celui‑ci a su jeter les bases d’un pouvoir personnel en dépit d’une forte contestation de différentes franges de la société (notamment les classes moyennes, surtout dans leur jeunesse).
Le génie despotique de l’État pétrolier iranien au moins autant que la personnalité autoritaire de l’ayatollah Khamenei se sont mutuellement prêtés main‑forte pour créer un pouvoir marqué par une dynamique perpétuant et renforçant l’autocratie. Cette dynamique rend plus aisée la tâche de l’Armée des pasdarans qui pourrait prendre la relève à la disparition de l’actuel Guide suprême. Sous l’égide de l’ayatollah Khamenei, l’Armée des pasdarans s’est transformée en un gigantesque conglomérat économique hors de portée du gouvernement légal et doté de tous les privilèges pour la doter d’un pouvoir financier à l’abri de tout contrôle légal.
L’ayatollah Khamenei a été marqué par une intelligence politique aiguë face à la crise du pouvoir, que ce soit après la mort de l’ayatollah Khomeyni, l’avènement du président réformateur Khatami en 1997, le mouvement de contestation étudiant en 1999, l’avènement du président Ahmadinejad (il a tenté de constituer une base autonome du pouvoir avant la fin de son second mandat en 2013) et surtout, le Mouvement vert en 2009. À chaque remise en cause de son pouvoir, il a agi avec sagacité, face à des présidents peu au fait des subtilités du pouvoir (notamment Khatami, plutôt un enseignant qu’une figure politique). Il a su se servir des différents leviers du pouvoir (le système judiciaire sous sa coupe, l’Armée des pasdarans qu’il a comblée de prébendes, les Fondations révolutionnaires ou pieuses – Astan Quds Razavi) afin de mater les adversaires internes. La nature du régime iranien favorise l’opposition entre le président de la République et le Guide suprême : la légitimité du premier est populaire (avec les restrictions d’un régime où l’élection reflète l’état de l’opinion même si elle n’est pas démocratique) lors même que celle du second est théocratique. L’ayatollah Khamenei a dû affronter non seulement les réformateurs, mais aussi l’ayatollah Rafsandjani qui visait à ouvrir le régime politique au prix de la marginalisation du Guide suprême et que ce dernier a su neutraliser. Plus les adversaires politiques ont été dominés, plus les tendances autoritaires de la théocratie de Velayat-e faqih (le pouvoir du jurisconsulte islamique) se sont accentuées et plus l’ayatollah Khamenei s’est trouvé confirmé dans son rôle de Guide suprême. Alors qu’en 1997 le mouvement de l’éveil de la société civile et la présidence de Khatami avaient un moment remis en cause la nature autocratique du pouvoir, le manque de cou‑ rage politique du Président, son absence d’expérience politique, mais aussi la peur d’une répression sanglante par Bassidje ont paralysé l’opposition à la théocratie islamique. L’ayatollah Khamenei a su consolider son pouvoir personnalisé qui, désormais n’est contesté par aucun pouvoir, si ce n’est la crise généralisée du régime face à l’hégémonie américaine dans la région, après la sortie des États‑Unis du traité de non‑prolifération nucléaire avec l’Iran et l’imposition des sanctions que l’Europe a dû suivre en dépit de sa détermination à respecter les termes dudit traité.
La contamination syrienne et les nouveaux autoritaires - Le Grand Continent
Pour l'ambassadeur français à Damas la guerre de Syrie doit être comprise " dans l'ombre portée de la Guerre d'Espagne " : les nouveaux mouvements autoritaires se sont nourris des violences de ...
https://legrandcontinent.eu/fr/2019/11/15/la-contamination-syrienne-et-les-nouveaux-autoritaires/
Les Russes et les Iraniens ont soutenu sans états d’âme et à fond le régime syrien comme l’Italie fasciste et l’Allemagne nazie avaient puissamment aidé le camp du Général Franco ; les dirigeants occidentaux n’ont que mollement appuyé les groupes armés rebelles syriens de même que leurs prédécesseurs des années 30 s’étaient abstenus de défendre le gouvernement républicain espagnol.
Poutine est intervenu en 2015 en Syrie pour sauver Assad, sans tirer un seul coup de fusil contre Daesh, laissant aux Occidentaux et à leurs alliés l’intégralité du combat contre le proto-Etat du Calife Baghdadi ; et Assad a largement contribué à l’apparition de Daesh, par la répression brutale qu’il a opposée au soulèvement syrien.
Les Républicains espagnols ont résisté à la menace d’une dictature en voie de formation, les insurgés syriens ont affronté une dictature établie
quel est le coût d’une politique de non-intervention ou d’une politique de faible intervention ?
parce qu’ils n’ont pas voulu utiliser le langage de la force contre Assad en 2011 et 2012, et plus encore en 2013, lorsque les circonstances s’y prêtaient, les puissances occidentales ont laissé se développer une situation sur le terrain favorables aux djihadistes ;
cette situation les a obligés contre leur gré à intervenir massivement à partir de 2015, contre Daesh, dans des conditions plus difficiles et à un coût plus élevé que s’ils avaient agi avec plus de détermination contre Assad au début du conflit.
L’idée de se battre pour ses valeurs s’estompe quand on ne sait plus très bien à quoi l’on peut croire.
Et comment croire à quoi que ce soit lorsque les gouvernants se montrent passifs ou impuissants face à des transgressions massives des normes d’humanité et de droits de l’homme qui fondent les société occidentales ?

La Guerre de Syrie se révèle être le cristallisateur de la montée en puissance des leaders néo-autoritaires comme la Guerre d’Espagne avait été le point de départ de la montée en puissance des régimes totalitaires.
c’est grâce à la Syrie que la Russie de Poutine a réussi son grand retour au Proche-Orient et, au-delà, restauré son statut de grande puissance sur la scène internationale ;
le conflit syrien a joué un rôle dans la déstabilisation de la Turquie et ce que l’on appelle la « dérive autoritaire » d’Erdogan ;
les attentats terroristes en Europe et l’afflux des réfugiés, conséquences du conflit syrien dans un cas comme dans l’autre, ont beaucoup contribué à l’émergence de l’extrême droite allemande et au succès des leaders populistes notamment en Pologne, en Hongrie, en Autriche et finalement en Italie.
Tout ne se ramène pas à la Syrie bien entendu et la montée en puissance des nouveaux autoritaires se serait vraisemblablement produite de toute façon
Dans le débat américain, le conflit syrien ne comportait pas d’enjeux réellement importants (no US major interests at stake) ?
Ainsi, avec la Syrie, nous sommes entrés dans un monde qui va très au-delà de la Syrie, et qui est le Monde des nouveaux autoritaires.
C’est le titre qui a été donné à un livre (aux éditions de l’Observatoire en collaboration avec l’Institut Montaigne) rassemblant dix neufs portraits, rédigés par des experts reconnus, de dirigeants actuels qui partagent une même hostilité à l’égard des principes du libéralisme politique.
Ces portraits avaient initialement été publiés dans le blog de l’Institut Montaigne dans le courant de l’année dernière.
Ils ont servi de support à une réflexion sur l’état du monde envisagé sous cet angle particulier : trente ans après la chute du Mur, la démocratie libérale est menacée de l’intérieur et assiégée de l’extérieur.
Notons au passage que cela ne diminue en rien la menace venant de l’extrémisme islamiste mais cela démontre que l’on ne saurait focaliser toute l’attention sur ce seul phénomène.
comme en fin d'article ci-dessus, Michel Duclos cite Nicolas Bavarez,
j'ai ajouté à la fin ( après la Syrie) sa derniére contribution au Figaro,du 10 novembre,sur les DEMOCRATIES d'après la Guerre Froide
Question d'actualité sur l'intervention turque en Syrie
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.) M. Jean-Claude Requ...
16.10.2019 : L'offensive turque, qui suit le retrait des troupes américaines, s'inscrit dans ce que l'ancien ambassadeur de France en Syrie, Michel Duclos, appelle « la géopolitique des nouveaux autoritaires ».
Ou quand la volonté de puissance intérieure et extérieure des dirigeants turcs, russes ou iraniens a fait de la Syrie le terrain de jeu mortifère de leurs ambitions.
/image%2F0960958%2F20190712%2Fob_2a4493_syriepay.jpg)
SYRIE et l'après Assad ? la longue nuit syrienne.
La Syrie des Assad : l'histoire sans fin. Depuis leur intervention militaire fin septembre 2015, les Russes ont toujours eu dans l'idée de changer le pouvoir politique en place à Damas. Vladimir ...
http://knock-on-wood.over-blog.com/2019/07/syrie-et-l-apres-assad.html

Avec le talent d'un vrai narrateur tapi dans l'ombre des sommets internationaux, l'ancien ambassadeur en Syrie Michel Duclos, expert du Moyen-Orient et analyste auprès de l'Institut Montaigne, nous fait pénétrer dans les arcanes de la diplomatie pour en dévoiler les sinuosités, les impasses, les frustrations et, parfois, les vanités. Le dossier syrien est pour lui un crève-coeur, un naufrage qu'il a suivi pas à pas, car il y voit la double défaite de l'Occident et de la négociation multilatérale, une déflagration globale. Voici des extraits significatifs des conclusions de son dernier livre, La Longue Nuit syrienne. Dix années de diplomatie impuissante*. C.M.
Extraits :La Syrie d'aujourd'hui est un pays exsangue. On l'a dit, huit ans après le début du soulèvement, on compte de 300 000 à 500 000 morts ; environ 7 millions de réfugiés (dont 5,6 recensés par le HCR) ont fui le pays, dont une partie s'entasse dans des camps dans des pays voisins ; il y aurait 1,5 million d'invalides et 80 000 détenus. En outre, plus de 6 millions de Syriens vivent cette situation difficile de "déplacés internes". [...] Cependant, puisque ce désastre absolu résulte d'une "guerre civile globalisée", il convient de rechercher une signification plus large à la tourmente qui a emporté la Syrie, de replacer celle-ci dans le contexte des grandes turbulences géopolitiques de notre époque ; il faut, en quelque sorte, s'interroger sur l'ombre portée sur le monde de la victoire d'Assad.
Victoire d'Assad ? Victoire usurpée, bien sûr, puisque, laissé à ses propres forces, le régime baasiste aurait été emporté par le soulèvement, sans doute dès 2012 et peut-être avant. Ce sont ses protecteurs, ainsi que la pusillanimité des Occidentaux, qui ont permis au régime de survivre, puis de vaincre. Victoire d'ailleurs incomplète, fragile, minée de l'intérieur par les ferments de révolte future qu'elle comporte, victoire peut-être en fait provisoire. [...] Sur le plan régional, le vrai vainqueur à ce stade est l'Iran.
La République islamique a réalisé son vieux rêve de disposer d'une tête de pont sur la côte méditerranéenne. Israël ne peut cependant accepter une installation en force de son ennemi juré, la République islamique d'Iran, à ses portes ; la Russie pourrait aussi chercher à limiter les gains acquis par Téhéran ; la Turquie n'a pas dit son dernier mot. Sur le plan global, c'est la Russie qui apparaît - là aussi pour le moment - comme le grand vainqueur du conflit. C'est vrai sous l'angle militaire, puisque, avec des moyens somme toute limités, elle a atteint ses objectifs ; c'est encore plus vrai d'un point de vue géopolitique : je retiens de visites régulières dans tout le Proche-Orient que M. Poutine y dispose désormais d'un capital d'autorité considérable, au point d'en faire, dans les yeux de beaucoup, le successeur légitime des Etats-Unis dans le rôle d'honest broker - de médiateur bienveillant dans les conflits entre Etats de la région.
Si la Russie a gagné, c'est surtout parce que les Américains, comme on l'a vu, ne se sont pas réellement battus. Non seulement ils ne se sont pas battus, mais le benign neglect - le dilettantisme - dont ils ont fait preuve en Syrie illustre une tendance plus générale à se retirer de la région ; ce "désengagement", comme l'on dit, même s'il n'est que relatif, a ouvert un vide stratégique dans lequel la Russie s'est engouffrée. Au fond, il y a peut-être moins eu victoire de la Russie que recul puis défaite de l'Occident. Et cette défaite a en quelque sorte été aggravée par les conséquences pour l'Europe de la guerre en Syrie : les attentats terroristes résultant de l'irruption des centrales terroristes au coeur du Proche-Orient, l'afflux des réfugiés lié en partie au conflit syrien, les séismes politiques que cela a entraînés dans la plupart des pays, notamment en Europe centrale et en Italie. [...]
Ainsi est venue l'heure des nouveaux autoritaires, dont le patriarche, le pionnier, sinon le chef de file, est bien M. Poutine. Il va de soi que celui-ci n'est pas intervenu en Syrie pour des raisons idéologiques mais je ne doute pas, ayant servi à Moscou comme à Damas, qu'il existe une bonne part d'affinités de "système à système" entre les dirigeants du Kremlin actuel et le régime de Damas : pour les uns comme pour les autres, un pays aux mains des services de sécurité a quelque chose de fondamentalement sain et rassurant.
Je l'ai dit : la Russie s'est coulée dans la plus sale des guerres, comme elle l'avait fait chez elle en Tchétchénie, sans aucune considération pour le droit humanitaire et le droit de la guerre. Ainsi, le recul de l'Occident en Syrie a [...] pris l'allure d'une véritable défaite parce qu'il a donné un avantage géopolitique à la Russie et à l'Iran, parce qu'il a eu des conséquences néfastes en Europe, provoquant sur le Vieux Continent une montée en puissance de l'extrême droite, parce qu'enfin il marque un affaiblissement dramatique des valeurs et des normes qui constituent encore, malgré Donald Trump, l'ethos de l'Occident. [...]
J'ajouterai que la priorité donnée par les nouveaux autoritaires de tous horizons au repli national met en danger les acquis de la coopération internationale. On le voit avec le sort de l'accord sur le nucléaire iranien et de l'accord sur le changement climatique, avec la remise en cause des traités de désarmement entre la Russie et les Etats-Unis ou avec le lancement d'une guerre commerciale tous azimuts par M. Trump, avec enfin la crise actuelle de l'Union européenne. [...]
Les Européens ont virtuellement disparu du Levant ; les Américains songent principalement à s'en retirer ; M. Poutine gère la suite du conflit syrien en priorité avec M. Erdogan, M. Netanyahou et la direction iranienne. [...] Allons plus loin : pour tenir compte des craintes de leurs opinions face aux questions migratoires, les gouvernements européens sont contraints de passer accord avec le néoautoritaire Erdogan. Les Emirats arabes unis - sous la conduite du néoautoritaire Mohammed ben Zayed - sont l'un des premiers candidats à la normalisation avec Assad.
La proximité affichée par M. Trump à l'égard de Mohammed ben Salmane, le prince héritier saoudien, a encouragé ce dernier ou son entourage à franchir une limite dans le mépris des droits de l'homme en commanditant l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul. Nous pourrions multiplier les exemples : le conflit syrien a déclenché une sorte de cercle vicieux dont pour l'instant les nouveaux autoritaires sortent renforcés. La guerre en Syrie a été l'épreuve qui les a mis en mesure de défier l'ordre international dit libéral. De surcroît, les nouveaux autoritaires se montrent capables jusqu'ici d'un degré de coopération (le "processus d'Astana", par exemple) impressionnant quand on pense à l'écart entre leurs points de départ.
[...] Le grand risque serait que la stratégie de tension, puis d'intervention militaire, de Vladimir Poutine apparaisse comme le modèle d'une stratégie qui fonctionne, d'une recette éprouvée pour le succès. Les Occidentaux, de leur côté, ou en tout cas les Américains, n'ont pas vu ou n'ont pas voulu voir que l'enjeu du conflit syrien dépassait de loin le sort de la malheureuse Syrie ; ils n'ont pas compris qu'en baissant la garde sur ces cases particulières du grand échiquier mondial, ils affaiblissaient leurs positions sur l'ensemble du plateau ; et qu'ils encourageaient leurs rivaux stratégiques à suivre des politiques de confrontation : c'est peut-être d'ailleurs la raison sous-jacente qui explique que les diplomates ne parviennent pas à trouver une approche consensuelle pour un règlement politique de la guerre en Syrie.
* La Longue Nuit syrienne. Dix années de diplomatie impuissante, par Michel Duclos. Ed. l'Observatoire, 240 p., 19 €.
L’année 1989 a marqué la fin du XXe siècle, court et tragique, qui s’ouvrit en 1914 et fut placé sous le signe des grandes guerres conduites au nom des idéologies. La chute du mur de Berlin, le 9 novembre, lança la désintégration de l’empire soviétique et entraîna la troisième grande vague de décomposition des empires après celles de 1918 et de 1945.
La démocratie sortit victorieuse des trois guerres mondiales, la dernière s’étant dénouée sur le plan politique et non militaire. La fin de la guerre froide et la chute de l’Union soviétique portèrent au zénith le modèle libéral. La dernière décennie du XXe siècle vit l’universalisation du capitalisme, la montée de la société ouverte et le progrès de la démocratie sur les cinq continents, donnant corps au mythe de la fin de l’histoire et de l’avènement de la démocratie de marché théorisé par Francis Fukuyama.
Trente ans après, le contraste est saisissant. L’économie mondiale, qui ploie sous les dettes accumulées pour éviter une grande déflation après le krach de 2008, est engagée dans la démondialisation, sous la pression de la guerre commerciale engagée par les États-Unis contre la Chine qui provoque le recul des échanges et des paiements internationaux. La société ouverte a été enterrée par le retour en force des nationalismes, avec pour symbole la construction de quelque 65 murs aux frontières des nations. La démocratie est partout sur la défensive, prise sous le feu croisé des menaces extérieures et intérieures. D’un côté, elle est désignée comme ennemi par les démocratures chinoise, russe ou turque, et par les djihadistes. De l’autre, elle est minée par les populistes et concurrencée par le modèle de la démocratie illibérale promu par Viktor Orban.
Une immense fatigue s’est emparée des peuples démocratiques, qui se traduit par le refus d’assumer la charge et la responsabilité de la liberté. La sécurité est désormais préférée à la liberté et l’identité à la citoyenneté, ce qui paralyse les institutions et défait les nations. Sur le plan international, l’Occident se décompose : les États-Unis, sous la houlette de Donald Trump, ont renoncé à la République comme à l’empire, laissant le champ libre aux démocratures et aux djihadistes ; l’Europe communie dans l’impuissance et les divisions.
Vladimir Poutine enterre certes trop vite démocratie et libéralisme en affirmant qu’ils appartiennent au passé. Dans le monde, émergent, de Hongkong à Caracas en passant par Alger, des hommes risquant leur vie pour tenter d’accéder à la liberté politique. Mais il reste que les démocraties ont perdu l’après-guerre froide. Alors que la liberté exige un travail permanent des individus et des nations sur eux-mêmes, les démocraties ont succombé depuis 1989 à la tentation de la complaisance et leurs citoyens à celle de vivre en rentiers.
La liberté s’est dégradée en rente, avec l’abandon de l’éducation et le mépris pour la connaissance, l’irrespect de l’État de droit, la déshérence des valeurs, au premier rang desquelles les droits de l’homme, ce qui a ouvert de vastes espaces aux démagogues, aux extrémistes et aux fanatiques. Le capitalisme s’est dégradé en rente, la chute de la croissance et de la productivité étant compensée par les bulles spéculatives qui ont permis de distribuer des richesses fictives sous la forme de dividendes pour les uns, de prestations sociales pour les autres. La mondialisation s’est dégradée en rente, avec un modèle insoutenable prétendant exporter la production et les emplois en Asie - avant tout en Chine - tout en conservant valeur ajoutée et profits en Occident, mais aussi avec l’accélération d’un capitalisme de prédation au moment où le dérèglement climatique menace de sortir de tout contrôle. Les technologies numériques se sont dégradées en rente accaparée par les monopoles du Gafam. Le leadership s’est dégradé en rente avec des guerres sans fin qui témoignent d’une égale incapacité à gagner au plan militaire et à conclure la paix au plan politique, avec des États-Unis qui prétendent rivaliser avec la Chine tout en liquidant les alliances et le système multilatéral qui fondaient leur puissance au nom d’un nationalisme à courte vue.
Le triomphe de 1989 s’est transformé en désoccidentalisation accélérée du monde. Le libéralisme s’est dissous dans le matérialisme, l’individualisme et le nihilisme. Les démocraties, toutes à l’euphorie d’une victoire qui était d’abord la défaite du soviétisme, ont perdu le contrôle de l’histoire du monde car elles ont cessé de chercher à le comprendre et à le stabiliser.
Les démocraties ont perdu la bataille de l’après-guerre froide mais pas la guerre du XXIe siècle. La liberté politique peut survivre si elles savent se réinventer. Il ne leur manque que l’essentiel : la raison politique pour les États-Unis ; le courage pour l’Europe.
Pendant ces douze dernières années ( avant 2016 parution du livre ) les pays subissant un déclin de leur environnement démocratique étaient chaque année plus nombreux que ceux dont la démocratisation progressait .
L’échec des « Printemps arabes », à l’exception de la révolution tunisienne, nous oblige d’autant plus à nous interroger sur ce retour à l’autoritarisme, mais également sur les déterminants favorisant la réussite des processus de démocratisation.
C’est ce que proposent Robert R. Kaufman et Stephan Haggard – respectivement professeurs aux Universités Rutgers et de Californie - dans Dictators and Democrats. Les deux politistes explorent les conditions favorables et défavorables à l’enracinement de la démocratie.
S. Haggard et R. R. Kaufman relèvent la prégnance d’un « syndrome de la démocratie faible » risquant d’entraver le processus de sortie de l’autoritarisme.
Il se manifeste à travers trois phénomènes :
- l’implication fréquente des militaires dans la sphère politique (ce que les deux politistes appellent le « prétorianisme »),
- un jeu politique faiblement institutionnalisé ,caractérisé par une marginalisation de l’opposition
- et par un exercice autoritaire du pouvoir de la part du parti vainqueur des élections), ainsi qu’une performance économique médiocre.
En soulignant le rôle négatif du prétorianisme sur les processus de démocratisation, les auteurs s’inscrivent également en faux contre la thèse d’Ozan Varol sur le « coup d’État démocratique » , d’après laquelle certaines circonstances spécifiques permettent aux putschs de remplir une fonction de sortie de l’autoritarisme.
Ils rappellent par ailleurs que, si les transitions démocratiques sont fragilisées par les crises économiques, celles-ci sont partiellement alimentées par certains dysfonctionnements institutionnels.
En prenant pour critère le degré de liberté qu’accordent les autorités aux mobilisations de la société civile, les auteurs proposent une distinction entre autoritarismes « ouvert » et « fermé » qui permet de mieux comprendre pourquoi certaines transitions démocratiques réussissent et d’autres non
Ainsi, les transitions structurées autour de conflits distributifs tendent à davantage se produire dans les régimes fermés à ce type de mobilisation que dans les régimes relativement ouverts.
Plus précisément, les régimes militaires ou monopartites auront plus de probabilités de faire face à des conflits distributifs que les régimes multipartites.
la mobilisation contre le régime « est une fonction de deux facteurs clés :
- la structure d’opportunité fournie par l’ordre autoritaire,
- et les ressources organisationnelles disponibles pour les contestataires ».

/image%2F0960958%2F20190627%2Fob_210d21_pouliguen.jpg)


/https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fprofile_images%2F688107668104282113%2FAOlfSGzS_400x400.jpg%23width%3D400%26height%3D400)





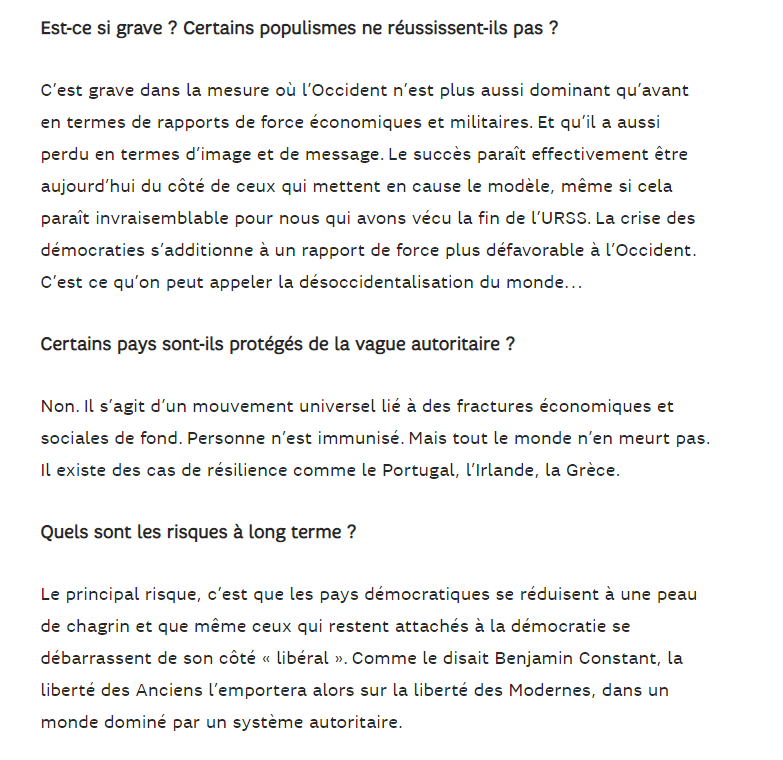
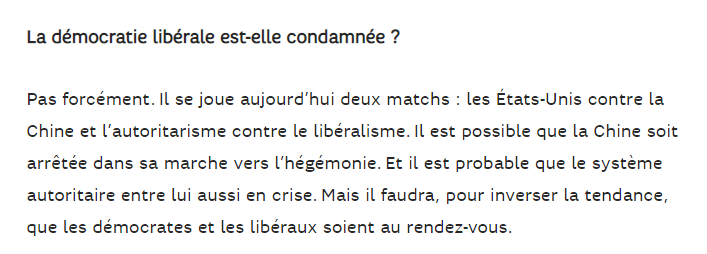

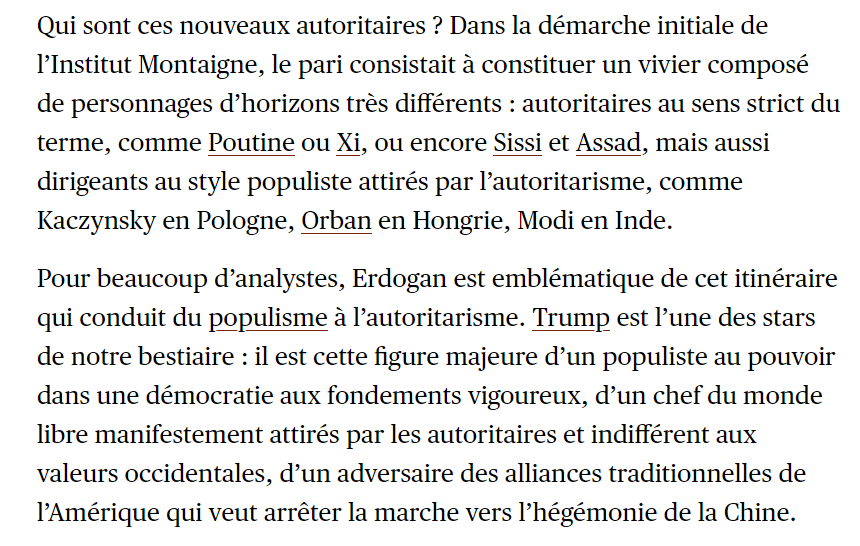








/https%3A%2F%2Flaviedesidees.fr%2Flocal%2Fcache-vignettes%2FL540xH356%2Fartoff4040-b5a43.png%3F1523257201%23width%3D540%26height%3D356)


/image%2F0960958%2F20240115%2Fob_01deeb_20240115-074401.jpg)
/image%2F0960958%2F20240101%2Fob_fcf751_photo-jd.jpg)
/image%2F0960958%2F20231021%2Fob_091d44_isl1.png)
/image%2F0960958%2F20231029%2Fob_a34b53_ue-passoire.png)
